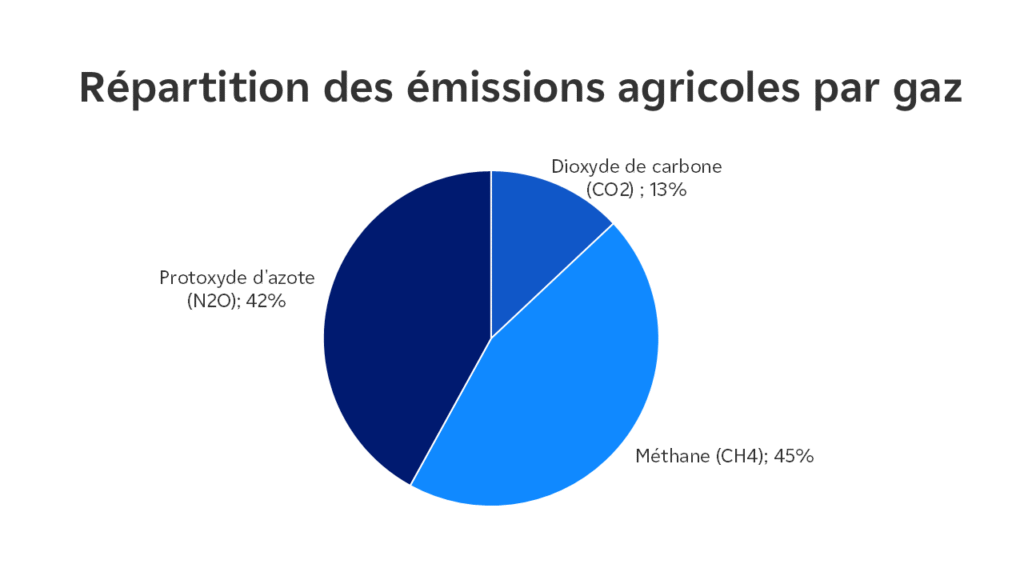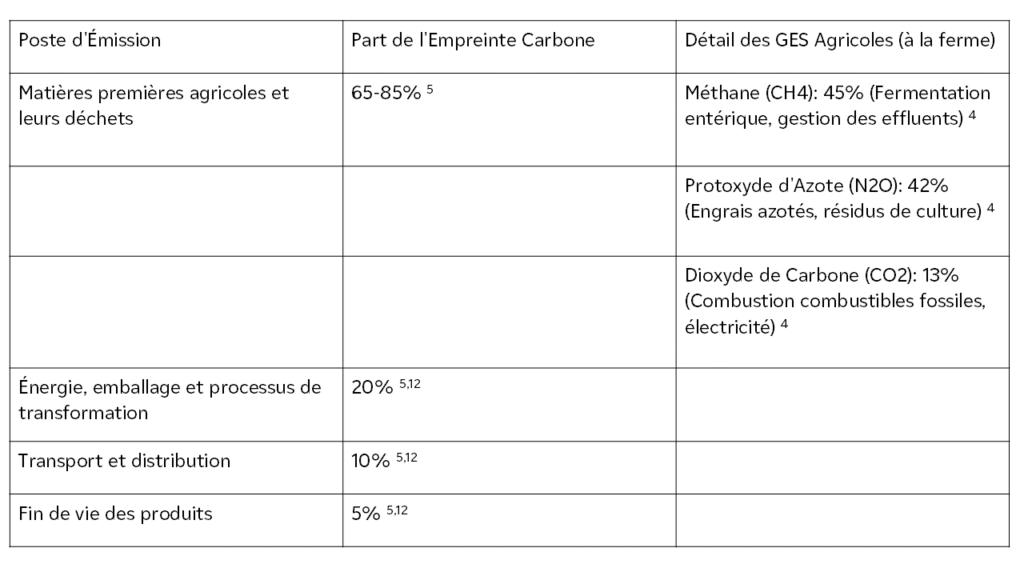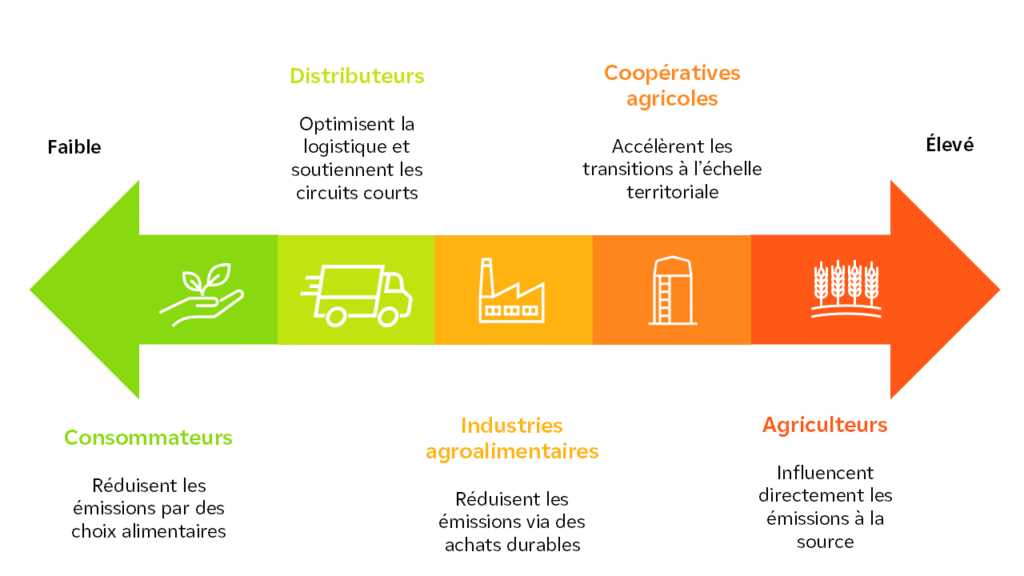Dévastée par une tornade, la forêt de Saint-Nicolas de Bourgueil retrouve vie petit à petit
Nichée au cœur de l’Indre-et-Loire, la forêt de Saint-Nicolas de Bourgueil a été durement frappée en 2021 par le passage d’une tornade. Compte tenu de la violence de l’épisode, avec des vents estimés entre 175 et 220 km/h, et de l’ampleur des dégâts infligés aux écosystèmes — près de 2 200 hectares dévastés — la mairie a souhaité engager un projet de restauration de cette forêt gravement endommagée. Dans ce contexte, EDF DPNT a cofinancé un projet de reboisement de 31 hectares, développé par Oklima, en collaboration avec l’ONF (Office National des Forêts).