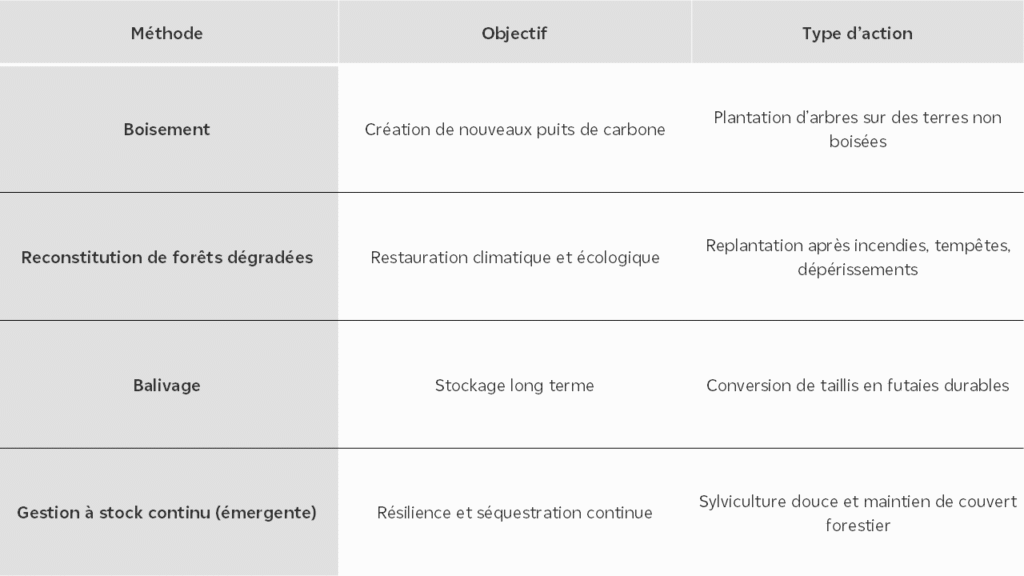Le Label Bas-Carbone : un levier pour l’emploi rural et la filière forestière
La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un objectif inscrit dans la loi Énergie-Climat et décliné à travers sa Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)1. Pour y parvenir, les territoires ruraux et forestiers deviennent des acteurs essentiels de la transition écologique, en misant notamment sur la séquestration du CO₂. Depuis 2018, le Label Bas-Carbone (LBC) accompagne cette transformation en finançant, via des crédits carbone, des projets locaux de réduction et de stockage des émissions. Parmi les bénéficiaires clés, les Entreprises de Travaux Forestiers (ETF) assurent la gestion durable des forêts et contribuent à l’économie locale, tout en préservant la santé des écosystèmes.